- 9.3.1.1 Présentation de l'algorithme en 2D.
- 9.3.1.2 Algorithme de Shepp et Logan.
- 9.3.1.3 Algorithme de Shepp et Logan en 3D.
Même si l'ensemble des procédures ont été écrites dans un souci de rapidité,
nous allons insister plus particulièrement sur 2 procédures: la rétroprojection
et le calcul du produit matriciel
![]() impliqué
dans la reconstruction algébrique. Ces deux procédures en effet, montrent comment
on peut tirer parti de la puissance de calcul du CRAY à l'aide des simples notions
que nous avons introduites précédemment.
impliqué
dans la reconstruction algébrique. Ces deux procédures en effet, montrent comment
on peut tirer parti de la puissance de calcul du CRAY à l'aide des simples notions
que nous avons introduites précédemment.
La rétroprojection est un mécanisme essentiel dans la reconstruction d'images.
Si on raisonne en 2D et si l'image est décrite sur une base de pixels, sa taille
est de dimensions
![]() . Un algorithme conventionnel
comme l'algorithme de Shepp et Logan requiert
. Un algorithme conventionnel
comme l'algorithme de Shepp et Logan requiert ![]() multiplications
et
multiplications
et ![]() additions. En passant en 3D, la complexité passe à
additions. En passant en 3D, la complexité passe à ![]() .
Ce surcoût de calcul reste encore à l'heure actuelle un handicap.9.4 C'est pourquoi, il s'avère impératif de réduire le temps de calcul nécessaire
à la rétroprojection. Les tentatives faites en ce sens peuvent être regroupées
en trois catégories:
.
Ce surcoût de calcul reste encore à l'heure actuelle un handicap.9.4 C'est pourquoi, il s'avère impératif de réduire le temps de calcul nécessaire
à la rétroprojection. Les tentatives faites en ce sens peuvent être regroupées
en trois catégories:
Concernant la deuxième catégorie, des solutions spécifiques ont été mises en place. Par exemple, un circuit spécialement conçu pour l'algorithme STRETCH a été utilisé par [96]. Plus récemment, un circuit permettant d'effectuer une interpolation bilinéaire nécessaire à la reconstruction 3D a été proposé [47]. Les temps de rétroprojection sont alors inférieurs à la minute.
Finalement le recours au parallélisme est une idée séduisante. D'une part par les fermes de PCs qui voient le jour actuellement. Et plus particulièrement au centre CYCERON puisqu'elle peut être facilement adaptée de manière performante à la machine dont nous disposons.
Rappelons que la projection bidimensionnelle analytique nous avait amené à écrire:

Inversement, la rétroprojection consiste à affecter en chaque point
![]() d'une image
d'une image
![]() la valeur de toutes les projections
la valeur de toutes les projections
![]() pour tous les couples
pour tous les couples
![]() tels que
tels que
![]() Ceci correspond à une étape de localisation qui consiste à chercher
quels sont les couples
Ceci correspond à une étape de localisation qui consiste à chercher
quels sont les couples
![]() ou ``faisceaux'' qui voient
ce pixel précis.
ou ``faisceaux'' qui voient
ce pixel précis.
L'interpolation représente la deuxième étape majeure de la rétroprojection. Il s'agit de la pondération des contributions des différents faisceaux à un pixel particulier.
La localisation consiste à récupérer, pour un angle de vue particulier, l'indice
![]() de la projection la plus proche et donc du faisceau le plus proche
contenant le point
de la projection la plus proche et donc du faisceau le plus proche
contenant le point ![]() considéré (Fig.10.6).
considéré (Fig.10.6).
La rétroprojection complète s'obtient ensuite par une sommation sur tous les angles de vue possibles:

Cet algorithme s'appuie sur le fait que notre image est discrétisée dans une
base de pixels. Dans cette base, les déplacements pour passer du centre d'un
pixel au centre d'un autre pixel suivant la direction ![]() (ou suivant la
direction
(ou suivant la
direction ![]() ) sont quantifiés par la la taille
) sont quantifiés par la la taille ![]() (ou
(ou ![]() )
du pixel suivant cette direction. Tout déplacement correspond à un multiple
de
)
du pixel suivant cette direction. Tout déplacement correspond à un multiple
de ![]() (ou
(ou ![]() ). De ce fait, pour un angle de vue
). De ce fait, pour un angle de vue ![]() donné, ce déplacement suivant
donné, ce déplacement suivant ![]() (resp.
(resp. ![]() ) une fois projeté conduit
à un incrément
) une fois projeté conduit
à un incrément ![]() suivant la direction
suivant la direction ![]() tel que:
tel que:
![]() (resp.
(resp.
![]() ). Il en découle alors l'algorithme
Alg.7
). Il en découle alors l'algorithme
Alg.7

Même si les auteurs ne précisent pas l'extension au cas 3D, il se déduit assez
facilement de l'algorithme bidimensionnel. Dans l'étape de localisation, il
sera alors nécessaire de repérer les valeurs ![]() et
et ![]() les
plus proches du point
les
plus proches du point
![]() correspondant à la projection
d'un voxel
correspondant à la projection
d'un voxel ![]() ainsi que les distances
ainsi que les distances
![]() et
et
![]() .
L'interpolation deviendra une interpolation bilinéaire:
.
L'interpolation deviendra une interpolation bilinéaire:
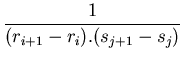 |
|||

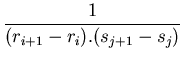 |
|||
Pour implémenter l'algorithme de Shepp et Logan en 3D, il faut également définir,
suivant les directions ![]() et
et ![]() , les incréments associés à la projection
des déplacements unitaires sur le volume suivant les directions
, les incréments associés à la projection
des déplacements unitaires sur le volume suivant les directions ![]() ,
,![]() et
et ![]() .
.
| 0 | |||
Le calcul des cosinus et sinus étant une opération coûteuse en temps de calcul, on calcule au préalable des tables de cosinus et sinus que l'on mémorise. On remplace ainsi le calcul par un accès mémoire.
On peut donc maintenant donner une version de l'algorithme de rétroprojection
3D (Alg.8).

L'interpolation intervient au coeur de cinq boucles imbriquées. On comprend
alors l'importance d'avoir diminué le nombre d'opérations requises pour son
calcul. D'autre part, la condition concernant la validité du capteur provient
du fait que certains voxels ne sont pas vus par tous les détecteurs (géométrie
cylindrique d'acquisition et caractère fini du sinogramme).
On constate que la valeur de ![]() correspondant à la coordonnée
suivant
correspondant à la coordonnée
suivant ![]() dans le plan de projection
dans le plan de projection
![]() est uniquement dépendante des coordonnées
est uniquement dépendante des coordonnées ![]() du voxel projeté (
du voxel projeté (![]() ).
L'idée est donc d'inverser l'ordre des boucles
).
L'idée est donc d'inverser l'ordre des boucles ![]() par
par ![]() ,
de sorte qu'avant de rentrer dans la boucle sur les
,
de sorte qu'avant de rentrer dans la boucle sur les ![]() , nous puissions
d'ores et déjà calculer
, nous puissions
d'ores et déjà calculer
![]() . Si cette valeur
. Si cette valeur ![]() conduit à un indice n'appartenant pas au sinogramme discret, nous pouvons ainsi
éviter une boucle sur les
conduit à un indice n'appartenant pas au sinogramme discret, nous pouvons ainsi
éviter une boucle sur les ![]() . Ceci est important puisque c'est la boucle
la plus externe qui est parallélisée. Après inversion de l'ordre, la boucle
sur les
. Ceci est important puisque c'est la boucle
la plus externe qui est parallélisée. Après inversion de l'ordre, la boucle
sur les ![]() correspond à la boucle la plus externe.
correspond à la boucle la plus externe.
Les accès mémoires sont importants et l'inversion de l'ordre de parcours du
volume conduit à un adressage qui n'est plus optimal avec la façon dont l'ordinateur
lit en mémoire. C'est pourquoi dans la rétroprojection, nous construisons un
volume
![]() que nous permutons à la fin de la procédure
pour obtenir
que nous permutons à la fin de la procédure
pour obtenir ![]() . L'algorithme de rétroprojection devient Alg.9.
. L'algorithme de rétroprojection devient Alg.9.

Nous pouvons également, dans certains cas, faire intervenir des symétries permettant
de minimiser la nombre d'itérations des différentes boucles [20].
D'une manière générale, dans l'ensemble des procédures, nous essayons de limiter
le nombre de divisions à l'intérieur des boucles, car cette opération coûteuse
requiert trois multiplications et une réciproque.
Rappelons que la reconstruction algébrique implique le système linéaire:
Cette opération revient à faire la projection d'une image.
En effet, partant d'un vecteur
![]() de dimensions
de dimensions ![]() (égales au nombre de voxels dans un volume émetteur), on obtient par l'utilisation
d'une matrice de dimensions
(égales au nombre de voxels dans un volume émetteur), on obtient par l'utilisation
d'une matrice de dimensions ![]() un vecteur de dimensions
un vecteur de dimensions ![]() (égales au nombre de détecteurs dans le sinogramme).
(égales au nombre de détecteurs dans le sinogramme).
Pour une matrice
![]() connue, la réponse impulsionnelle
sur les détecteurs pour une source ponctuelle s'obtient en considérant un vecteur
connue, la réponse impulsionnelle
sur les détecteurs pour une source ponctuelle s'obtient en considérant un vecteur
![]() (une image) non nul pour une seule de ses composantes (sorte
de dirac discret) et par l'application de Eq.10.3. Inversement,
dans la colonne
(une image) non nul pour une seule de ses composantes (sorte
de dirac discret) et par l'application de Eq.10.3. Inversement,
dans la colonne ![]() de
de
![]() est stockée la réponse
impulsionnelle sur les
est stockée la réponse
impulsionnelle sur les ![]() détecteurs pour une source ponctuelle unitaire
placée en
détecteurs pour une source ponctuelle unitaire
placée en ![]() (Fig.10.7).
(Fig.10.7).

|
Cette opération consiste à faire la rétroprojection (backprojection)
d'une série de mesure
![]() sur les détecteurs.
En effet, partant d'un vecteur
sur les détecteurs.
En effet, partant d'un vecteur
![]() de dimensions
de dimensions ![]() (égales au nombre de détecteurs dans le sinogramme), on obtient par l'utilisation
d'une matrice de dimensions
(égales au nombre de détecteurs dans le sinogramme), on obtient par l'utilisation
d'une matrice de dimensions ![]() un vecteur de dimensions
un vecteur de dimensions ![]() (égales au nombre de voxels dans un volume émetteur)
(égales au nombre de voxels dans un volume émetteur)


|
Notons que dans le cas tridimensionnel, la matrice
![]() est
de dimension conséquente (
est
de dimension conséquente (
![]() ).
C'est pourquoi nous envisageons la reconstruction algébrique après rebinning.
Le sinogramme sera donc de taille
).
C'est pourquoi nous envisageons la reconstruction algébrique après rebinning.
Le sinogramme sera donc de taille ![]() fois plus petite. Mais surtout
le rebinning décompose le problème de reconstruction 3D en une série
de reconstructions 2D par tranche. Autrement dit, on peut considérer une matrice
fois plus petite. Mais surtout
le rebinning décompose le problème de reconstruction 3D en une série
de reconstructions 2D par tranche. Autrement dit, on peut considérer une matrice
![]() par tranche transaxiale. Chaque matrice n'est plus alors
que de dimension
par tranche transaxiale. Chaque matrice n'est plus alors
que de dimension
![]() . Si du plus,
nous considérons une invariance de la matrice
. Si du plus,
nous considérons une invariance de la matrice
![]() suivant
la direction
suivant
la direction ![]() , nous avons alors une seule matrice (notée
, nous avons alors une seule matrice (notée
![]() par la suite) pour les
par la suite) pour les ![]() plans à reconstruire. De ce fait, nous travaillons
maintenant en 2D. La reconstruction consiste alors partant d'un sinogramme ``rebinné''
à estimer le volume en calculant
plans à reconstruire. De ce fait, nous travaillons
maintenant en 2D. La reconstruction consiste alors partant d'un sinogramme ``rebinné''
à estimer le volume en calculant ![]() images 2D. Ceci nous permet de
paralléliser avec une forte granularité, car nous obtenons une indépendance
entre les
images 2D. Ceci nous permet de
paralléliser avec une forte granularité, car nous obtenons une indépendance
entre les ![]() reconstructions. Nous pouvons donc maintenant poursuivre
le raisonnement en 2D en envisageant la reconstruction d'un plan transaxial
précis.
reconstructions. Nous pouvons donc maintenant poursuivre
le raisonnement en 2D en envisageant la reconstruction d'un plan transaxial
précis.
Par la suite, nous faisons les hypothèses supplémentaires:
Une fois l'invariance de la réponse impulsionnelle posée, on peut
chercher les redondances présentes dans la matrice produit
![]() et donc réduire calculs et espace mémoire en construisant directement
cette matrice. On s'affranchit ainsi de la construction de la matrice
et donc réduire calculs et espace mémoire en construisant directement
cette matrice. On s'affranchit ainsi de la construction de la matrice
![]() et du produit matriciel
et du produit matriciel
![]() .
.
Considérons deux composantes ![]() et
et ![]() du vecteur image.
Exprimer le produit
du vecteur image.
Exprimer le produit
![]() , c'est chercher à exprimer
la rétroprojection en
, c'est chercher à exprimer
la rétroprojection en ![]() de la projection d'une source ponctuelle
placée en
de la projection d'une source ponctuelle
placée en ![]() . La valeur de
. La valeur de
![]() est
la somme des contributions de chaque détecteur pondérées par la réponse impulsionnelle
d'une source ponctuelle placée en
est
la somme des contributions de chaque détecteur pondérées par la réponse impulsionnelle
d'une source ponctuelle placée en ![]() (Fig.10.8 et Fig. 10.9
).
(Fig.10.8 et Fig. 10.9
).
Fixons une direction de projection ![]() et notons par
et notons par ![]() la
distance qui sépare les droites de projection suivant
la
distance qui sépare les droites de projection suivant ![]() relatives
à
relatives
à ![]() et
et ![]() .
. ![]() représente toujours l'abscisse
de la projection suivant
représente toujours l'abscisse
de la projection suivant ![]() de
de ![]() (Fig. 10.9
).
(Fig. 10.9
). ![]() comme
comme ![]() sont dépendants de
sont dépendants de ![]() (
(
![]() ).
Nous avons donc :
).
Nous avons donc :
on intègre sur ![]() :
:
Puis on intègre le résultat suivant ![]() :
:
![]() apparaît donc comme la fonction d'autocorrélation
de la réponse impulsionnelle
apparaît donc comme la fonction d'autocorrélation
de la réponse impulsionnelle ![]() à la distance
à la distance ![]() . 9.5
. 9.5
Pour l'intégration de (10.5) suivant ![]() , il est nécessaire
de définir explicitement
, il est nécessaire
de définir explicitement
![]() en fonction des écarts
en fonction des écarts ![]() et
et ![]() séparant les deux pixels considérés.
séparant les deux pixels considérés.
On pose alors
![]() qui nous permet de réécrire
la distance
qui nous permet de réécrire
la distance
![]() comme:
comme:
En rappelant que la fonction modifiée de Bessel de premier ordre ![]() est telle que:
est telle que:

Un calcul analogue à ce qui vient d'être fait montre que

La fonction ![]() peut être prolongée par continuité puisque :
peut être prolongée par continuité puisque :
Pour construire la matrice
![]() partant de
partant de
![]() ,
il n'est pas nécessaire de conserver toutes les valeurs de
,
il n'est pas nécessaire de conserver toutes les valeurs de
![]() pour
les différents couples
pour
les différents couples
![]() possibles
dans l'image à reconstruire. En effet, pour construire la valeur de
possibles
dans l'image à reconstruire. En effet, pour construire la valeur de
![]() pour un couple
pour un couple
![]() particulier, on peut utiliser un tableau
particulier, on peut utiliser un tableau
![]() à deux dimensions.
à deux dimensions.
![]() caractérise
les écarts possibles entre pixels suivant la direction
caractérise
les écarts possibles entre pixels suivant la direction ![]() pour l'image
envisagée et
pour l'image
envisagée et
![]() ceux suivant
ceux suivant ![]() . En effet, les
déplacements sur l'image sont quantifiés par la taille du pixel
. En effet, les
déplacements sur l'image sont quantifiés par la taille du pixel ![]() et
et ![]() conduisant à
conduisant à
![]() et
et
![]() .
On remplit le tableau
.
On remplit le tableau ![]() en utilisant Eq.10.12 et Eq.10.13.
Autrement dit
en utilisant Eq.10.12 et Eq.10.13.
Autrement dit
![]() . Pour
les indices
. Pour
les indices ![]() et
et ![]() dans l'image tel que
dans l'image tel que
![]() et
et
![]() . On obtient la valeur de
. On obtient la valeur de
![]() par
par
![]() . On peut donc ainsi de manière
très simple et très rapide recalculer n'importe quelle ligne où
colonne de la matrice produit
. On peut donc ainsi de manière
très simple et très rapide recalculer n'importe quelle ligne où
colonne de la matrice produit
![]() (Voir Fig.10.12).
De plus, on diminue la taille de la matrice
(Voir Fig.10.12).
De plus, on diminue la taille de la matrice
![]() de manière importante. En effet, pour une image ECAT HR+ classique,
de manière importante. En effet, pour une image ECAT HR+ classique,
![]() .
La taille globale de
.
La taille globale de
![]() serait normalement
serait normalement
![]() ,
ici elle n'est plus que de
,
ici elle n'est plus que de
![]() soit
soit ![]() fois plus
petite. De plus, on s'affranchit du produit matriciel
fois plus
petite. De plus, on s'affranchit du produit matriciel
![]() .
Pour des raisons de symétrie de révolution de la fonction
.
Pour des raisons de symétrie de révolution de la fonction ![]() , on peut
encore diminuer la taille du tableau
, on peut
encore diminuer la taille du tableau ![]() par 4 en travaillant sur
les valeurs absolues des écart
par 4 en travaillant sur
les valeurs absolues des écart ![]() et
et ![]() .
.
On obtient alors les algorithmes Alg.10

pour la construction du
![]() et Alg.11
et Alg.11

pour le produit matriciel partant de cette matrice.